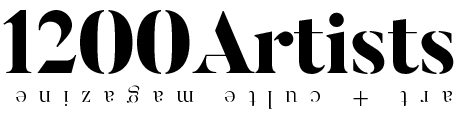Être dans un dessin animé, c’est un peu comme être en enfer. Peu importe la fréquence à laquelle Daffy Duck se fait tirer dessus au visage, les animateurs le bénissent avec un rétablissement complet, afin qu’il puisse recommencer à être torturé dès que possible. Daffy n’est pas si différent des pécheurs de Dante Enfer, perpétuellement noyé dans la merde ou rôti ou bouilli, ou Lucifer dans le livre I de Milton paradis perdu, enchaîné dans le feu. Je ne suis pas le premier à le remarquer : la connexion Daffy-Lucifer a inspiré John Ashbery pour écrire son poème « Daffy Duck à Hollywood » (1975), et John Berger a basé l’un de ses meilleurs essais sur la parenté secrète de Walt Disney et Francis Bacon. . Bien sûr, être dans un dessin animé ressemble plus amusant que d’être piégé dans une cage de verre ou un lac enflammé, mais, comme le savait Lucifer de Milton, l’agonie peut aussi être amusante.
Le caricaturiste Gary Panter connaît son Milton, et son Dante, et ses Looney Tunes, et son Disney, et comme Ashbery, il sait les mélanger dans un plat aigre-doux. Pris un par un, ses dessins ont la grossièreté hâtive et idiote des marginaux des manuels scolaires. Dans l’ensemble, ils deviennent aussi sombres et denses qu’une carcasse de bœuf Chaim Soutine. Peu de personnages meurent dans sa première bande dessinée, publiée pour la première fois en 1988 et récemment rééditée par New York Review Comics, mais ils supportent des coups de feu, des coups de couteau, des visages fondus, des électrocutions, une armée de cafards géants et une explosion nucléaire. La collection aurait vraisemblablement pu s’appeler La vie en enfer si l’ami proche de Panter, Matt Groening, n’avait pas déjà utilisé ce titre pour sa propre bande dessinée. Au lieu de cela, il s’appelle Jimbo : Aventures au paradis.
Qui est Jimbo ? « Punk tout le monde » est la description habituelle ; un autre pourrait être « Bart Simpson, s’il avait vieilli avec son émission de télévision tout en soufflant de la colle et en s’entraînant deux fois par jour. » Jimbo a le corps de Dwayne Johnson et la coupe de cheveux de Bart (ou plutôt, Bart a celle de Jimbo ; Groening a dessiné le personnage en hommage à Panter – même maintenant, quelqu’un fait probablement une thèse sur d’autres liens entre les univers « Simpsons » et Jimbo). Il a aussi fière allure en kilt. Il est un habitué des dessins de Panter depuis les années 1970, lorsque l’artiste est arrivé à Los Angeles et a commencé à développer ce qu’il a décrit comme son esthétique de « cohérence décousue ». Jimbo est la partie cohérente, le héros dont la similitude désinvolte et invincible nous guide à travers le chaos de tout le reste.
Quand je dis tout le reste, je veux dire tout le reste. Aventures au paradis a un complot, mais seulement dans le sens où Burroughs Déjeuner Nu ou Ballard’s L’exposition des atrocités avoir des parcelles – mieux vaut dire qu’il a des sauts d’aiguille, des embardées, des coupes qui ne réduisent jamais. Au début du livre, Jimbo se trouve dans la métropole martienne de Dal-Tokyo – pensez au vrai Tokyo, puis ajoutez des robots et vaporisez tout de crasse – mais il est difficile de dire s’il y reste. Il descend un égout, découvre un club underground, prend une pilule et se réveille au lit quelque temps plus tard. Est-il toujours sur Mars ? L’a-t-il déjà été ? À la page vingt, nous pourrions aussi bien être à Durant, en Oklahoma, où Panter est né, ou au Jardin des délices de Bosch, où je soupçonne que Panter aimerait aller quand il mourra. Jimbo visite un fast-food qui lit dans ses pensées (vous évite le stress de choisir) ; plus tard, il est arrêté pour être trop pauvre pour acheter le fast-food qu’il n’a jamais commandé. Il fuit la civilisation pour vivre dans un wigwam et jouer au noble sauvage, mais à la fin du livre, la bombe a explosé et il n’y a plus de civilisation à fuir.
Est-ce le paradis ? La réponse facile est non, bien sûr que non, la plaisanterie de Panter – encore une fois, la plaisanterie vous permet de dire la vérité. Le heavy-metal-Inferno sur le côté droit du triptyque de Bosch m’a toujours plus ravi que le Muzak Eden sur la gauche, et je suppose que Panter (sans parler de Bosch) ressent la même chose. Son Dal Tokyo est peut-être mouvementé et dégoûtant, mais il est aussi vivant, comique et cinétique et fourmille d’idées. Comme le réalisateur Terry Gilliam, dont le film Brésil est sorti quelques années auparavant Aventures au paradis, Panter porte l’allusion sur sa manche, de sorte que même à leur plus sombre, ses créations palpitent avec la joie de leurs influences. Philip K. Dick serait fier de son restaurant de hamburgers, la structure de la vignette quasi connectée est du pur Burroughs, le fouillis furieux et les hachures doivent une dette de la taille d’un prêt étudiant à Robert Crumb et au métro de San Francisco. Paradoxalement, le résultat de tous ces emprunts est un véritable original – un rappel aussi que la culture américaine de la fin du XXe siècle était si riche que même ses cauchemars dystopiques étaient des fêtes.
Il est terrifiant de voir à quel point le pessimisme de cette époque semble optimiste. Dans Aventures au paradisdu point de vue de l’avenir, nous sommes tous foutus, bien sûr, mais au moins nous pouvons aller sur Mars, traîner avec des robots sensibles, étendre, accélérer, etc. Les quatre dernières décennies semblent avoir apporté quelque chose comme un grand abaissement des attentes, que David Graeber a décrit ainsi : « Un esprit timide et bureaucratique imprègne tous les aspects de la vie culturelle. Il est orné d’un langage de créativité, d’initiative et d’entrepreneuriat. Mais la langue n’a pas de sens. . . . La nation la plus grande et la plus puissante qui ait jamais existé a passé les dernières décennies à dire à ses citoyens qu’ils ne peuvent plus envisager de fantastiques entreprises collectives. Graeber a distingué les scientifiques et les politiciens pour leur imagination débordante, mais la classe créative n’est pas épargnée – il suffit de regarder l’extraordinaire succès de Marvel Studios, la société dont la pyrotechnie pétillante et la gestion de marque déguisée en divertissement sont l’ombre du Tradition américaine de la bande dessinée à laquelle Gary Panter a tant apporté.
Avant que les bandes dessinées ne deviennent des romans graphiques et les romans graphiques se sont transformés en films de super-héros et les films de super-héros sont devenus de vieux films, il y avait le Défenseur. Fondée en 1905, la Défenseur de Chicago était l’un des principaux journaux noirs du pays pendant plus d’un siècle, jusqu’à sa mise en ligne uniquement en 2019. Si vous étiez un dessinateur noir vivant dans le Midwest, c’était l’endroit où vous vouliez être publié, au début parce que c’était l’un des les quelques endroits qui a fait publier des bandes dessinées noires et plus tard parce que c’était la plus prestigieuse. Maintenant que toutes les bandes dessinées, pas seulement celles d’auteurs noirs, suivent le chemin du dodo, du DVD et du Défenseurédition imprimée de , nous avons au moins quelques belles anthologies à attendre avec impatience.
Les dessins animés du Défenseur forment l’épine dorsale de C’est la vie telle que je la vois : les dessinateurs noirs à Chicago, 1940–1980, un autre volume essentiel de New York Review Comics. Le titre est tiré de la légende d’un panneau unique de 1970 de Charles Johnson, ce qui se rapproche le plus d’un nom familier dans le monde du dessin animé noir, même si sa renommée a plus à voir avec son roman de 1990. Passage du milieu et sa bourse MacArthur qu’avec son art. Le panneau en question montre un critique d’art blanc, un peintre noir avec un grand afro, et son dernier tableau, qui est complètement, obstinément, sans vergogne noir. Un autre dessin animé de la même année montre un membre du Klan qui récite ses prières nocturnes : « Donnez-moi la force d’éliminer les gens inférieurs qui ruinent ma nation. » Le Klansman reçoit une réponse immortelle des cieux – « Sho ’nuff boss ! » – pour laquelle ils auraient dû donner à Johnson son Genius Grant à ce moment-là.
Artistes d’une race dépréciée, pratiquant une forme d’art dépréciée, vivant dans une ville dépréciée (la troisième est très loin de la première ou de la deuxième) – il n’est pas étonnant que la dépréciation soit un thème presque constant de ce livre. La série de Tom Floyd L’intégration est une chienne !, de 1969, est une splendide comédie de poisson hors de l’eau, sur un employé noir et son nouveau bureau en col blanc. Tout le monde est un peu trop enchanté de l’avoir là : la secrétaire baratine sur le « gentil homme de couleur » qui lui coupe l’herbe, le président arbore un kufi, etc. Plus tard, l’employé noir se venge en applaudissant, dans une salle de cinéma bondée de blancs, à une scène où un membre d’une tribu africaine attache un explorateur à un arbre.
Définir une esthétique de bande dessinée noire est un jeu de tasse, pour lequel les exceptions sont nécessairement plus nombreuses que les exemples. (Comme pour souligner ce point, le titre de ce livre n’est pas un prédicteur fiable de son contenu ; plusieurs bandes dessinées ont été dessinées après 1980, et une a été dessinée en 1990). Tout de même, chaque publication a un style maison. Le début Furieux les membres du personnel du magazine, presque tous juifs des grandes villes, ont été les pionniers d’une bande dense, sale et infestée de détails dans laquelle rien ne s’insère ou ne sort (« gras de poulet » était le terme inimitable et convenablement sémitique du rédacteur en chef Harvey Kurtzman). A en juger par cette anthologie, les caricaturistes de la Défenseur (et Jet, et Ébène, et Nègre Digest) privilégiait les compositions plus clairsemées, une comédie de l’isolement plutôt que du désordre. Même lorsque les images sont encombré, l’œil est dirigé vers une zone, généralement là où se trouve la figure noire. Lorsque vous êtes la seule personne noire dans l’un de ces panneaux, ce qui est assez souvent, vous triomphez en possédant votre personnalité unique, en vous démarquant avec style. D’où des applaudissements pour le membre de la tribu africaine, d’où la peinture de la toile blanche en noir, d’où le détachement lors d’une soirée WASP serrée, d’où bon nombre des meilleures blagues de ce livre.
Il est tentant, avec chaque semaine d’apporter des nouvelles d’un autre périodique auguste prisé ou lobotomisé, pour célébrer l’ancien imprimé Défenseur pour avoir existé, bien qu’il y ait une différence entre célébrer et idéaliser. le Défenseur a donné aux dessinateurs noirs un public et un salaire stable, mais cela les a également forcés à travailler rapidement et avec parcimonie et à répondre à une salle remplie d’éditeurs qui n’ont pas été embauchés pour leur sens de l’humour pétillant.
Ce n’est pas par hasard que les dessins animés les plus ravissants de C’est la vie telle que je la vois ont été auto-édités. le Défenseur a dirigé l’aventure afrofuturiste de Turtel Onli NOG, Protecteur des Pyramides pendant trois mois en 1979; après cela, il l’a dirigé lui-même. Des pages entières de la bande dessinée limitent l’abstraction – un panneau montre « un spectre itinérant d’énergie organique » qui ressemble à un mirage rugissant et sifflant – c’est donc le plus souvent l’élan des compositions qui vous pousse de page en page. « Life in America » de Yaoundé Olu (1982) a un style plus mignon, plus subtilement malveillant qui correspond trop bien à la gaieté creuse de l’ère Reagan.
Olu et Onli semblent avoir fait la même déduction à peu près au même moment : si les joueurs hérités nous paient à peine un salaire décent pour une version édulcorée de notre travail, pourquoi ne pas tout faire nous-mêmes et voir ce qui se passe ? À l’heure actuelle, tous ceux qui travaillent et pensent devraient se poser cette question, car telle est la vie en Amérique. Ou l’enfer. Ou le paradis.