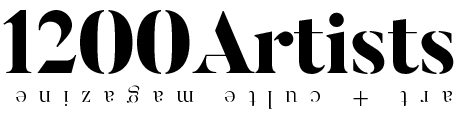Face aux visiteurs qui arrivent à cette petite mais frappante exposition d’œuvres de Jorge Tacla se trouve une peinture d’un grand socle, dépourvue de son sujet célèbre. Une paire de taches grises spectrales s’élèvent du socle – à la base duquel le spectateur est placé en perspective – comme une vague allusion à cette absence. Avec ses ornements néobaroques agités par le coup de pinceau flou caractéristique de l’artiste, une partie de sa technique de cire froide, le monument n’offre aucun indice quant à son emplacement précis. Le titre du tableau, Identité occulte 160 (Hidden Identity 160, 2021), confirme cet anonymat. Mais même dans sa solitude et le bleu générique de son ciel, le site ne se détache guère de l’actualité.
Sur une marche de la fondation de la structure apparaît le mot vit, à peine perceptible au milieu d’autres griffonnages de graffitis illisibles, mais rendant le piédestal immédiatement reconnaissable – non pas comme un site spécifique, mais dans le cadre des manifestations mondiales exigeant justice pour la violence policière en cours contre les corps noirs ; c’est un monument de fortune à la brutalité trop répandue. Le piédestal vacant évoque également le discours en cours (pour euphémiser son vitriol fréquent) sur le retrait des statues des suprématistes blancs et des propriétaires d’esclaves. Tacla utilise une combinaison finement affinée de dessins au trait et de lavages de couleurs pour créer des surfaces floues et turbulentes, une qualité formelle qui souligne la teneur idéologique de son imagerie. L’agitation incessante de ses peintures confère même à la matière la plus apparemment inerte un sentiment d’urgence historique.
Si les corps sont absents de Identité occulte 160elles font l’unique objet de Rapport de blessure 22 (2022). Les yeux bandés, les poings fermés et la bouche ouverte – vraisemblablement dans un chant collectif – un groupe de femmes défile en plein air dans ce qui ne peut être qu’une manifestation politique, menée dans un espace public, vraisemblablement urbain, étant donné les faibles contours des bâtiments dans l’arrière-plan. Malgré le ciel d’un rouge profond menaçant, aucun blessé n’est visible. Mais le sentiment de violence imminente de l’image éclate dans Rapport de blessure 17 (2022). Étendu au sol dans un espace plus compact et peu profond, un personnage est soit aidé à se relever, soit poussé vers le bas. D’autres personnages indistincts l’entourent, dont l’un tend le bras en signe d’aide ou d’agression. Frôlant l’abstraction, le tumulte strié des corps est encore estompé par des coulures de pigment cramoisi, à la fois immanentes à la scène et aussi événement pictural se cumulant à la surface du tableau. La toile elle-même semble une victime sanglante de la même démonstration.

Avec l’aimable autorisation de la galerie Cristin Tierney, New York
Bien que ces œuvres soient encore généralisées, des images comme 25 octobre #4, 2019 et 25 octobre #5, 2019 (tous deux de 2022) évoquent à travers leurs titres des épisodes récents de la vie politique du Chili natal de l’artiste, avec des foules manifestantes, encore totalement anonymes, constituant la matière première formelle des images. Ce dernier divise ses multitudes en six grandes sections monochromes entourant un rectangle central de rouge vif : une esquisse architecturale d’une rue bordée d’immeubles, représentant peut-être un site de troubles. La première œuvre mêle corps et paysage urbain : un monument au cœur du tableau apparaît englouti par des drapeaux et des corps qui ont arraché son importance historique à leurs propres fins. Les drapeaux apparaissent aussi illisibles que les paramètres régionaux sont indescriptibles. Le 25 octobre est la date de l’une des plus grandes manifestations de masse de l’histoire du Chili, qui s’est déroulée à Santiago en 2019 en réponse à l’augmentation du coût de la vie et des inégalités sociales, mais l’imprécision des scènes les relie à des manifestations mondiales plus larges et contemporaines (comme les Black Lives Démonstrations de matière auxquelles ses autres images font allusion). Les visages et les corps expressément embrouillés dans les peintures de Tacla créent la distance que l’on attend d’un souvenir ou d’un rêve ; leur imprécision étudiée infléchit leur présence avec la temporalité fugitive des ruines. L’artiste ne semble pas prendre parti en soi. Mais le fait de ces manifestations, ce mélange de corps dans l’espace agitant pour le changement, témoigne d’un besoin humain vital, de plus en plus menacé. Et la sélection d’événements auxquels ses titres font référence, parmi lesquels l’explosion de Beyrouth en 2020 (dans un ensemble de peintures non présentées ici), indique une orientation sociopolitique.

Avec l’aimable autorisation de la galerie Cristin Tierney, New York
Plus frappantes encore que les images expressément civiques de l’artiste sont ces paysages urbains évacués de toute présence humaine identifiable mais chargés de ses effets. Le Capitole des États-Unis se dresse à un angle oblique dans Rapport de blessure 16 (2022), en pleine allusion à l’insurrection du 6 janvier 2021. Ses bâtiments quelconques baignés d’un uniforme rouge cendré, Identité occulte 163 (2022) suggère, avec de la fumée ou du feu s’échappant d’un édifice central en feu, un pays non identifié en proie à des troubles politiques. Au lieu de sa cire et de ses pigments habituels, l’artiste a ajouté ici de la poudre de marbre, ce qui donne à la peinture plus de substance et une gravité matérielle étrange. Le fait que l’espace conceptuel entre les sites nommés par Tacla – le phare de la démocratie et de la « liberté » occidentales, les rivages étrangers où l’Amérique a parrainé des coups d’État illégitimes et les monuments plus proches de chez nous où un manque aigu de liberté est nommé – s’est rétréci de manière si drastique souligne l’horrible situation de la politique populiste. Telle est la subtile réalisation de la peinture de Tacla : avec cette exposition, il confirme sa présence parmi ces quelques peintres figuratifs contemporains, de feu Juan Genovés à Julie Mehretu, encore dignes du titre de « peintre d’histoire ».