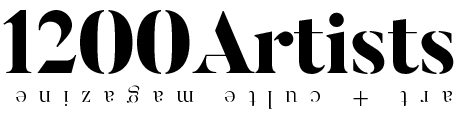Une étude de 2011 à l’University College de Londres a révélé que lorsque nous contemplons une œuvre d’art agréable, le sang se précipite dans notre tête dans un réflexe physiologique qui s’apparente à regarder un être cher. Qu’est-ce qui explique une séduction aussi immédiate et inconsciente ? Dans son nouveau livre Affinités : D’art et de fascination, le critique et essayiste Brian Dillon prend ce rapport instinctif comme point de départ d’une série de méditations élégantes et discursives sur les enchantements de l’art. Le livre est le troisième d’une trilogie consacrée à la lecture attentive; ses prédécesseurs, Essayisme (2017) et Supposons une phrase (2020), étaient respectivement des hymnes aux essais et aux phrases. Dans Affinités, Dillon tourne son attention vers les images, et est à nouveau un charognard longiligne. Son matériel source – photographies, images fixes de films et gravures, entre autres artefacts – s’étend chronologiquement du XVIIe siècle au verrouillage pandémique de 2020. Chaque chapitre riffs sur une image, traçant les contours de la biographie d’un artiste ou suivant les propres associations intuitives de Dillon. Des poids lourds tels que Warhol, Arbus et Eggleston se mêlent à des sujets plus ésotériques comme les auras migraineuses, l’adaptation télévisée de 1981 de Brideshead revisité, et les observations astronomiques du XIXe siècle du polymathe anglais John Herschel. Entrelacé avec ces courtes exégèses, un « essai sur l’affinité » en dix parties déballe le bagage historique, étymologique, conceptuel et personnel du terme. Le résultat est une enquête provocante et ouverte sur l’attrait ineffable de l’art.
Dillon commence par des négociations sémantiques. « Comment décrire, en tant qu’écrivain, la relation qu’il semblait que les artistes avaient avec leurs élus et non élus – quel est le mot ? Des talismans ? Goûts? Sympathies ? Des familiers ? Des superstitions ? Affinités, » il écrit. Il décrit l’affinité comme « quelque chose qui ressemble mais pas à l’intérêt critique, qui a ses propres excitations mais reste trop souvent au niveau de la connaissance, de l’analyse, des conclusions, au pire l’ennui total d’avoir des opinions ». La marque d’affinité de Dillon va plus loin que les recommandations algorithmiques d’Internet et est plus authentique que les parentés fabriquées annoncées dans les supports marketing. L’affinité, écrit-il, c’est comme la fascination, mais non. C’est un frère moins sentimental à apprécier : un terme avec la même lignée mais un caractère différent. C’est au-delà de l’esthétique. C’est impermanent. En fin de compte, ce n’est même pas pensable – un « mode de fascination stupide ». Ailleurs dans le livre, il décrit la tentative d’analyser l’affinité comme « stupide » et « idiote ». Son terrain de jeu thématique ici est l’écart entre la façon dont l’art nous transperce et notre incapacité à articuler cette transfixion. (Livre de TJ Clark de 2006 sur Poussin, La vue de la mort, partage un tel langage ; il se demande si seulement « le physique, littéral, idiot » Le fait de regarder peut satisfaire l’esprit.)
Il est risqué de structurer un livre comme une sorte de Wunderkammer— et s’il se dissipe dans son propre éclectisme ? — et plus risqué encore de présenter des artistes embaumés par des décennies d’analyse. Mais la méthode relutive de Dillon est elle-même une démonstration textuelle d’affinité qui aide ses différents sujets à être cohérents. Des artistes qui ont leur propre chapitre réapparaissent dans des chapitres sur les autres : William Klein est invoqué aux côtés d’Arbus et du photographe japonais Kikuji Kawada ; Claude Cahun est mentionné en lien avec Dora Maar et Francesca Woodman. Les chapitres se succèdent dans de subtils embellissements, faisant écho ou annotant des thèmes antérieurs. Dans le premier essai, par exemple, Dillon considère le livre de Robert Hooke Micrographie, le premier livre en anglais à présenter des observations faites au microscope. « Parmi les illustrations les plus connues de la première édition de 1665 figurent celles montrant l’œil à multiples facettes d’une mouche, les formes étoilées des cristaux de glace et une prodigieuse puce dépliante hérissée », écrit Dillon. Il est suivi d’un chapitre sur l’œuvre de Louis Daguerre. Vue du boulevard du Temple (ca. 1838), une photographie d’une rue de Paris que l’on pense être la première à représenter des personnes vivantes : les apparitions maculées d’un homme et de son cireur de bottes. Rien ne relie ces deux œuvres, sauf une analogie que Dillon laisse implicite : tout comme un microscope révèle le monde invisible qui nous entoure, une photographie peut éclairer ce que nous ignorons généralement.

Cette approche discrète est typique de Dillon. Il écrit de manière atmosphérique et impressionniste plutôt que critique. Voici comment il décrit une photo de la danseuse Loie Fuller : « Elle ressemble à un avion primitif qui se désagrège, un doux Blériot désintégré. À propos du sujet âgé d’une photo d’Eggleston des années 1970, dont la robe multicolore se heurte au coussin floral sur lequel elle est assise, il écrit : « Elle tient sa cigarette comme si elle pouvait disparaître au milieu de tout cet excès de motifs. Dans l’ensemble de parias et d’inadaptés d’Arbus, il discerne une « distance aristocratique » – une phrase appropriée dont la justesse n’évoque pas une image en particulier, mais toute la perspective impartiale de l’œuvre d’Arbus.
Comme il sied à un livre conçu pendant la pandémie, Affinités est introspectif et élégiaque par intermittence, même s’il recherche la communion. Dans son chapitre sur Vue du boulevard du Temple, Dillion se souvient d’avoir marché dans Londres au printemps 2020. Il note « une catégorie de citadins qui semblait soudainement plus visible qu’avant » – des camarades londoniens confinés en promenade qui, comme les figures fantasmatiques de Daguerre de près de deux siècles plus tôt, sont rendus nouvellement vifs par leurs circonstances. Un chapitre sur le Memorial to Heroic Self-Sacrifice, un monument à Londres dont les plaques enregistrent des histoires de gens ordinaires qui sont morts en sauvant la vie d’autrui, commence comme une autre scène pandémique avant de prendre une tournure plus philosophique. « Les choses qu’une nation peut se cacher à l’intérieur d’une idée d’héroïsme », songe Dillon, notant que de nombreuses plaques potentielles sur le monument restent vierges. Les élisions, souvent conceptuelles, reviennent tout au long du livre, surtout dans le dernier chapitre, qui énumère « des images qui ne sont pas mentionnées et n’apparaissent pas dans ce livre, mais qui ne quitteront pas l’esprit ». (Parmi les disparus : la représentation du photographe français Jacques Henri Lartigue de son chat attrapant une balle ; le Polaroid du cinéaste Andrei Tarkovsky de sa femme et de leur chien debout près d’une clôture en Russie.)
Ces images manquantes sont parallèles à l’un des sous-textes du livre : la relation oblique et non reconnue des artistes au modernisme, que Dillon définit au sens large comme la tendance esthétique à l’ambiguïté et à l’expérimentation formelle. Il suggère que la photographe du XIXe siècle Julia Margaret Cameron pourrait être considérée comme une moderniste, ses portraits flous et ses tableaux vivants représentant « un effort délibéré pour capturer quelque chose d’évanescent mais de particulier ». Le photographe et cinéaste français Jean Painlevé, qui a réalisé des documentaires lyriques sur la vie aquatique, est un autre moderniste, celui qui s’occupe « des minuscules épines sur le rostre d’une crevette avec l’œil abstrait que Karl Blossfeldt a apporté aux fougères fougères ou László Moholy-Nagy à la géométrie d’une rue de la ville. (Notez avec quelle grâce Dillon pose des affinités supplémentaires.) Si une partie du projet de Dillon consiste à récupérer ou à creuser des lignées de modernisme, alors une autre définition de l’affinité émerge. Être moderne, c’est connecter une chose à une autre. L’affinité est connexion; l’affinité est moderne.
Mais l’affinité est aussi, finalement, une humeur, comme le concède Dillon. Et l’ambiance est intime dans deux chapitres consécutifs – les plus émouvants du livre – qui regardent en dehors du canon vers des images plus quotidiennes, voire vernaculaires. Dans le premier, Dillon considère une photographie de presse d’une congrégation chrétienne charismatique, prise à Dublin dans les années 80 ou 90. « Leurs visages composent une sélection d’extases mondaines, telles que je les connais bien de certaines églises de mon enfance », écrit-il. Sa mère, en proie à la dépression et, plus tard, à une maladie auto-immune mortelle, appartenait à une telle congrégation, une « sororité ravie des malades et des malheureux ». Dillon reconnaît le fantôme de sa mère sur les visages de ces pèlerins d’âge moyen, dont l’un offre ses mains dans un geste suppliant ou interrogateur. Dans le chapitre suivant, il parle de sa tante, dont les griefs paranoïaques contre ses voisins ont abouti à une série d’instantanés de reconnaissance pris autour de sa propriété : des haies, des portes, des fenêtres. « Vous pouvez poursuivre la vigilance et l’attention dans une sorte d’état de fugue, presque hallucinatoire », écrit Dillon. Il fait référence à sa tante, mais la ligne a un ton prudent, gêné et châtié.

Avec l’aimable autorisation de l’auteur
Ce ton revient quelques pages plus tard, lorsque Dillon avoue un soupçon que « rien de ce que j’écris ne poursuit un argument ou n’est construit pour convaincre. Au lieu de cela, je me mets simplement dans une humeur à propos de la chose sur laquelle je suis censé écrire et je poursuis cette humeur jusqu’à ce qu’elle soit épuisée ou ait rempli l’espace qu’elle était censée remplir. Il a raison, bien sûr, mais il est en bonne compagnie : Wayne Koestenbaum, Maggie Nelson, Walter Benjamin et, surtout, Roland Barthes partagent tous la méthode dilatoire et mémorielle de Dillon. Comme ces écrivains, Dillon revitalise les images en respectant leurs ambiguïtés et énigmes inhérentes plutôt qu’en cherchant à les résoudre. (Une autre citation : Dillon appelle le travail du photographe japonais Rinko Kawauchi « une photographie domestique, dédiée à une infinité de petites choses, incroyablement tendres et exposées ».) Dillon est extrêmement sensible à la sous-fréquence de ses images choisies, et il les considère avec curiosité et examen attentif.
Dans l’un des derniers chapitres du livre, il écrit sur la dernière interview télévisée que le dramaturge britannique Dennis Potter a faite, en 1994, peu de temps après avoir reçu un diagnostic de cancer en phase terminale. Potter fait remarquer que la mort imminente a rendu le monde presque hyperréel – plus radieux, plus pleinement lui-même. Dillon réalise un miracle similaire dans ces pages, le «miracle banal du regard», comme il l’appelle. Les images qu’il contemple deviennent plus nettes et plus étranges, alignées de multiples façons impénétrables les unes sur les autres et sur le monde. C’est un processus irréductible qui est finalement au-delà de notre compréhension mais auquel il est impossible de résister – quelque chose, peut-être, comme l’amour.