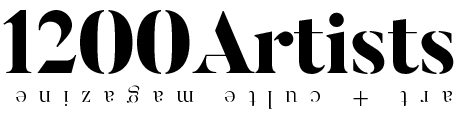Hervé Télémaque, un artiste français né en Haïti dont les œuvres poignantes luttant contre le racisme et le colonialisme n’ont obtenu que récemment une reconnaissance grand public en Europe et aux États-Unis, est décédé jeudi dans un hôpital près de Paris. Il avait 85 ans.
L’Aspen Art Museum dans le Colorado, qui héberge maintenant une version de l’enquête Télémaque apparue pour la première fois aux Serpentine Galleries à Londres, a annoncé le décès de Télémaque. Le musée a déclaré qu’il luttait contre une maladie auto-immune.
Télémaque s’est avéré un personnage difficile à classer. Au cours des années 60, il a été regroupé avec le mouvement Narrative Figuration, un style français qui cherchait à faire revivre la peinture figurative en tant que stratégie politique de gauche. Il a également été considéré comme un artiste pop et, dans une exposition récente présentant une histoire mondiale du surréalisme, il a également été qualifié de figure tangentielle de ce style.
Mais dire que Télémaque est membre de l’un de ces mouvements ne rendrait pas suffisamment compte du dynamisme et de la complexité de son art, qui reprenait souvent des histoires de racisme et de colonialisme – et leur influence continue sur le présent – de manière frappante et ambiguë.

Photo Sandra Pointet/Fondation Gandur pour l’Art, Genève
Il est surtout connu pour des œuvres comme 1965 36 000 Marines sur nos Antilles, qui traite du rôle du gouvernement américain dans la formation d’un régime communiste en République dominicaine. Une image d’une femme élégante, des vêtements, un soldat qui court, un cordon téléphonique bleu et des pas sont placés sur un fond rouge-orange chaud, ainsi que du texte en français et en anglais. On ne peut confondre la position anti-consumériste et anti-establishment de la peinture, mais ce que, exactement, Télémaque essaie de dire avec toute cette imagerie est plus difficile à cerner.
Télémaque a été explicite sur sa position d’homme noir d’origine haïtienne vivant dans un pays occidental en proie au racisme.
« Je suis moi-même un produit du colonialisme français en Haïti, qui à l’époque s’appelait Saint-Domingue », a-t-il déclaré au Journal d’art. « Et donc, il était naturel que cela alimente ma réflexion. Et ça continue encore. Regardez ce qui se passe en France aujourd’hui.
Hervé Télémaque est né à Port-au-Prince, Haïti, en 1937. Comme il l’a dit au Journal d’art, il est issu d’une « famille d’artistes », avec un oncle poète et une tante pianiste. Une fois le dictateur François Duvalier arrivé au pouvoir, Télémaque part en 1957 pour New York, où il étudie avec l’Art Students League.

Photo Cyrille Chauvet/Musée d’Art Moderne et Contemporain de Saint Etienne Métropole
A New York, Télémaque rencontre l’expressionnisme abstrait. Il admirait profondément le mouvement, mais éprouvait des réserves quant à la manière dont il précepte – sa tendance à des plans de couleur englobants et son objectif de susciter un sentiment transcendant – pourrait devenir «décoratif», comme il l’appelait.
Moins de cinq ans après son arrivée à New York, il quitte la ville, en 1961, pour Paris, constatant que le racisme qu’il a subi quotidiennement aux États-Unis lui est devenu insupportable. Dans des interviews, il a décrit ne pas pouvoir louer un studio simplement parce qu’il était noir. « Le racisme était sous-jacent à tout ici », a-t-il déclaré Actualités Artnet. « N’étant pas en mesure de trouver un studio, je pense que cela vous donne une bonne idée de la situation. »
Il a trouvé Paris une ville beaucoup plus accueillante pour les artistes noirs et il s’est lancé dans la création d’œuvres qui lui conféreront une renommée internationale bien plus tard. Il a peint des tableaux tels que Sans titre (The Ugly American), 1962/64, une grande toile qui enracine les préjugés qu’il a subis à New York dans une histoire plus large de violence. Des caricatures racistes volent autour du tableau tandis que des silhouettes blondes crachent le mot « STOP » ; une collection d’individus sans visage dans un coin représente Fidel Castro et Toussaint Louverture.
Sa série « Banania », réalisée à la même époque, reprend des images racistes qui se frayent un chemin dans les pages des journaux français, sur les étagères des épiceries et sur les écrans de cinéma. Ma Chérie Clémentine (1963), par exemple, met en scène un personnage dansant entouré d’une publicité pour un produit capillaire divisé en deux, l’une de ses moitiés étant remplacée par l’image d’un monstre.
Dans les années 70, il renonce entièrement à la peinture pour se consacrer au dessin et au collage. Ce dernier médium était en partie un clin d’œil au métier de sa femme Maël, qui travaillait comme couturière, un métier qui consiste à couper et assembler à plusieurs reprises divers matériaux.

Centre national des arts plastiques, Paris/Musée national d’art moderne, Centre de création industrielle, Paris
Lorsque Télémaque est revenu à la peinture dans les années 80, les œuvres qu’il a produites étaient tout aussi audacieuses qu’elles l’avaient été près de deux décennies auparavant. Mère Afrique (1982) place une photographie de l’époque de l’apartheid d’une nounou noire et d’un enfant blanc en Afrique du Sud à côté d’une caricature de Joséphine Baker. Entre les deux pend un fouet en cuir.
Bien que Télémaque ait affirmé avoir pris sa retraite dans des interviews récentes, il a continué à peindre dans les dernières décennies de sa vie. Lorsque sa maladie a rendu sa main droite inutilisable, il a commencé à utiliser sa gauche pour peindre.
Ce n’est que récemment que la plupart des plus grands musées du monde ont remarqué Télémaque. Bien qu’il ne s’agisse pas de sa première rétrospective à Paris, son exposition de 2015 au Centre Pompidou a beaucoup contribué à susciter un plus grand intérêt pour son art, tout comme son inclusion dans l’exposition révolutionnaire de 2016 « Postwar », organisée par Okwui Enwezor et Katy Siegel, qui racontait l’histoire de l’art d’après-guerre sans eurocentrisme. Son art est apparu dans le rehang du Museum of Modern Art en 2019, et son exposition Serpentine a suivi en 2021.
En plus de l’exposition du musée d’art d’Aspen en ce moment, une petite enquête sur les premiers travaux de Télémaque se rendra à l’Institut d’art contemporain de Miami plus tard ce mois-ci.
Interrogé en 2019 par Actualités Artnet comment il ressentait la réception changeante de son travail, Télémaque a déclaré: « Les choses sont toujours trop lentes, vous savez, c’est comme ça. »