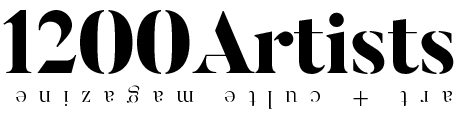En 1949, sept ans après avoir fui une Europe en guerre pour Mexico, l’artiste et écrivain Leonora Carrington (1917-2011) a lu un livre très curieux. Robert Graves Déesse blanche: une grammaire historique du mythe poétique, publié un an plus tôt, était un récit mythographique de la manière dont le paganisme sous-tend la croyance chrétienne. Il postulait l’existence d’une «Déesse blanche de la naissance, de l’amour et de la mort» affiliée à la lune, que les structures patriarcales obscurcissent. Selon Graves, on ne pourrait pas réussir à écrire de la poésie sans servir cette divinité féminine:
La raison pour laquelle les poils se dressent, les yeux pleurent, la gorge est serrée, la peau rampe et un frisson coule dans la colonne vertébrale quand on écrit ou lit un vrai poème est qu’un vrai poème est nécessairement une invocation de la Déesse Blanche, ou Muse, la Mère de tous les vivants, l’ancien pouvoir de la peur et de la luxure – la femelle araignée ou la reine-abeille dont l’étreinte est la mort.
Les méthodes savantes de Graves étaient suspectes, son ton était de révérence et peut-être de conviction obsessionnelle, ses phrases élaborées, ses sources obscures. TS Eliot a qualifié le livre de «prodigieux, monstrueux, stupéfiant, indescriptible» et Laura Riding, ancienne collaboratrice littéraire et partenaire romantique de Graves, ne l’aimait pas beaucoup. Riding avait le sentiment que ses propres convictions spirituelles avaient été parodiées par son ex dans ce qui équivalait à une «abomination pute». Graves semble également avoir inventé ses traductions de la poésie celtique, en s’appuyant sur une compréhension limitée de la langue. Une série de déductions basées sur une prétendue relation entre les lettres de l’alphabet celtique et certains arbres lui ont permis, selon lui, de découvrir des noms divins cachés dans l’écriture ancienne. Pourtant, sa conclusion générale tout à fait raisonnable – que la religion monothéiste moderne a effacé d’autres systèmes pluralistes consacrés au matriarcat et au culte de la nature – a trouvé un écho chez de nombreux lecteurs non universitaires, et le livre a été publié en plusieurs éditions en 1948, 52 et 61. Il est depuis devenu un classique du paganisme contemporain.
Carrington, qui avait précédemment écrit un certain nombre de nouvelles dans une veine surréaliste piquante – dont beaucoup critiquaient le christianisme – a pris note. Après avoir absorbé la fantastique enquête de Graves, l’artiste britannique a écrit son premier et unique roman, La trompette auditive, un conte du bouleversement apocalyptique de la vie d’une femme âgée. C’est clair La trompette auditive a été fortement influencé par la mythologie révisionniste de Graves: le manuscrit, selon la spécialiste de Carrington Susan L. Aberth, a été achevé en 1950. Cependant, il n’a été publié qu’en 1969, dans une traduction française intitulée Le Cornet acoustique. En 1974, il est apparu simultanément aux États-Unis et au Royaume-Uni, dans l’original anglais.

Avec l’aimable autorisation de NYRB Classics
Imprimé dans plus de vingt éditions et dans six langues au cours des quarante dernières années, l’histoire de Carrington a de nouveau été rééditée en janvier par New York Review Books, avec une postface de la romancière polonaise et lauréate du prix Nobel Olga Tokarczuk. Après des critiques élogieuses dans le New York Times et le New yorkais par Blake Butler et Merve Emre, respectivement, le premier tirage s’est vendu en un mois. Cet exploit, ainsi que les récentes rééditions des deux autres œuvres littéraires majeures de Carrington – ses mémoires de détention dans un établissement psychiatrique espagnol pendant la Seconde Guerre mondiale, En bas (NYRB, 2017), et ses nouvelles collectées (Dorothy, A Publishing Project, également 2017) – suggèrent que son auteur est à nouveau à la hausse, peut-être en raison d’un intérêt renouvelé pour l’occulte parmi les lecteurs de la génération Z et du millénaire. Mais comment devrions-nous penser à ce qu’Emre appelle la tendance de Carrington à «renaître» continuellement, si elle n’a jamais été pleinement domestiquée ou canonisée? Compte tenu de son statut à la fois de peintre brillante et de conteuse enchanteresse, Carrington pourrait-elle être plus à l’aise – et, par conséquent, plus reconnaissable en tant qu’artiste majeur – à notre époque de plus en plus interdisciplinaire? Et pourquoi a-t-elle elle-même attendu près de deux décennies pour publier son œuvre littéraire la plus pleinement réalisée?
Butler et Emre sont tous deux enthousiasmés par le roman de Carrington. Pour Butler, c’est une découverte: un «chef-d’œuvre époustouflant», plein d’humour et d’événements rares qui laissent le lecteur «reconfiguré». Emre, déjà converti, y voit un témoignage de l’étonnante capacité de Carrington à accoupler «l’artificiel au naturel» – une capacité qui reflète l’ambivalence perpétuelle de l’homme à l’égard de la technologie et de notre nature animale. Les deux critiques remettent en question la réputation de Carrington en tant que fille qui a battu les surréalistes à leur propre jeu, pour paraphraser un peu avec désinvolture. Elle a été annoncée à Paris par André Breton et al., Qui ont apprécié sa beauté et son esprit éduqué, comme un exemple de l’intersection de femme enfant et femme sorcière, réalisé en chair vivante. Bien qu’elle ait eu une relation juvénile célèbre avec l’artiste Max Ernst à la fin des années 1930 et au début des années 40, Carrington a finalement rejeté le rôle de muse. Pourtant, c’est par le surréalisme qu’elle a trouvé son chemin vers sa pratique de la peinture remarquablement expressive: l’effort qui, en 1938, a produit sa célèbre Autoportrait (auberge du cheval de l’aube), une image saisissante de l’artiste se mariant avec une hyène et un cheval à bascule alors qu’il était vêtu d’une paire emblématique de jodhpurs blancs.
Cette peinture, basée sur des couleurs non mélangées et un onirisme psychologique, est un prélude à l’œuvre mature plus lyrique et fantastique de Carrington, produite à Mexico après la Seconde Guerre mondiale et caractérisée par une application délicate de tempera à l’œuf. À Mexico, Carrington a collaboré étroitement avec le peintre hispano-mexicain Remedios Varo et la photographe Kati Horna. Et elle a aménagé son espace de vie pour accueillir ses différents rôles, en tant que mère de ses deux fils (par son second mari, le photographe Csizi «Chiki» Weisz), gardienne de la maison et peintre. L’atelier de Carrington englobait toutes ces activités: c’était la cuisine, le laboratoire, la crèche, le salon et l’étude, tout en un. En ce sens, il exprimait l’orientation changeante de Carrington vers l’imagerie, l’histoire et le travail artistique. Moins préoccupés par les juxtapositions figuratives choquantes et la révélation de pulsions psychologiques inconscientes si chères à la version bretonne du surréalisme, les tableaux mexicains de Carrington méditent sur la magie et le divin, principalement tels qu’ils se manifestent dans un éventail internationaliste de traditions populaires. C’est dans ce contexte que La trompette auditive doit être lu.
Ce roman à la première personne concerne le sort – que nous considérons d’abord malheureux – d’une femme de 92 ans, Marian Leatherby, qui vit au Mexique avec son fils et sa désagréable épouse anglaise. Marian, comme elle nous le dit, a une barbe grise et une audition limitée. Grâce à un cadeau opportun – la trompette titulaire – de son amie Carmella, une ancienne artisan de pulls en fourrure de chat, Marian surprend sa famille qui complote pour l’envoyer dans une maison pour personnes âgées. Mais quel endroit cela s’avère être! Les habitants sont installés dans des cabanes fantastiques («des habitations bizarres – en forme de champignon, un chalet suisse, une momie égyptienne, une botte, un phare – impossible et absurde, tout droit sorti d’un tableau de Bosch»); le directeur, le Dr Gambit, est un évangélique influencé par Gurdjieff et obsédé par l’aérobic; et il y a un complot de meurtre impliquant des chocolats toxiques. Cependant, de peur que l’histoire de Carrington n’apparaisse comme un simple câlin farfelu édulcorant la propre critique d’Ernst des mœurs victoriennes dans son roman de collage de 1934, Une semaine de bonté (Une semaine de gentillesse), elle abandonne rapidement le récit institutionnel. Une ère glaciaire menace brusquement toute vie terrestre, alors même que les animaux et les humains sont attirés par magie par le retour imminent de la déesse blanche, un énorme beelike qui exige un culte orgiaque via la danse et le dîner, généralement les deux à la fois.
La trompette auditiveLe non-sens de la musique est moins surréaliste que synthétique. Ce qui avait semblé être un roman devient, en conclusion, une sorte de poème cyclique en prose d’adoration, un peu comme les œuvres celtiques Graves plié à sa volonté dans La déesse blanche. Carrington semble faire allusion aux divinités Tuatha Dé Danann de la légende irlandaise, avec leur déesse mère Dana, dont elle avait entendu parler dans son enfance par son infirmière irlandaise et dont elle avait lu le récit de quête comique de James Stephens. Le pot d’or (1912). Le roman de Carrington combine des éléments de la légende arthurienne, de la culture mexicaine, des mythes irlandais et du spiritisme proto New Age, avec une lueur de l’esprit du conte de fées européen.
Dans ce sens, La trompette auditive semble particulièrement à l’aise dans le contexte d’autres œuvres folkloriques de fiction féministe anglophone publiées dans les années 1970, et on se demande si Carrington était à l’avant-garde d’une sorte de zeitgeist. Les années 1970 ont vu un certain nombre d’œuvres notables de fiction et de critique liées aux contes de fées et au folklore, dans lesquels ces formes vernaculaires sont plus ou moins minutieusement repensées. Le plus célèbre d’entre eux est le roman de Toni Morrison Chant de Salomon (1977) et le recueil de nouvelles d’Angela Carter La chambre sanglante (1979). (Carter possédait une première édition de 1974 de La trompette auditive.) Les publications de Bruno Bettelheim ont également été publiées au cours de la décennie Les utilisations de l’enchantement: la signification et l’importance des contes de fées (1976), une lecture psychanalytique de contes de fées que l’on pense maintenant en grande partie plagiés à partir d’autres travaux savants, et de Marina Warner Seul de tout son sexe: le mythe et le culte de la Vierge Marie, sorti la même année. Toutes ces œuvres explorent la signification du folklore par rapport à la formation de l’identité personnelle. Contrairement à Graves, cependant, leurs auteurs ont absorbé les leçons du structuralisme et construit leurs arguments en décrivant des systèmes sociaux plus larges, plutôt que d’essayer de retracer des généalogies élaborées jusqu’à une source de croyance singulière.
Bien que je partage une partie de l’enthousiasme de Butler et Emre pour La trompette auditive, aujourd’hui, il semble plus daté que les histoires courtes précédentes de Carrington; elle est moins ennuyée par les restrictions sociales de la civilisation occidentale et plus utopique et émerveillée, et parfois cette merveille est obtenue par le biais d’un mysticisme festif qui peut se sentir un peu forcé. Ce qu’aucune revue récente ne mentionne, c’est que c’est aussi une histoire de la fin du monde – que Carrington prédit, de manière ambivalente, comme un moment où les femmes prendront enfin et une fois de plus le contrôle de l’histoire.