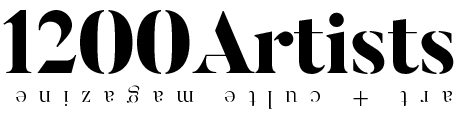Tle premier livre je sorti de ma bibliothèque à la suite de l’explosion dévastatrice du port de Beyrouth en août Of Cities & Women (Lettres à Fawwaz), un recueil de correspondances écrites par l’artiste, poète, écrivain Etel Adnan entre 1990 et 1992. Elle a écrit les lettres de différentes villes et les a adressées, comme le titre l’indique, à son amie l’historienne libanaise Fawwaz Traboulsi. Les paroles d’Adnan me revenaient de plus en plus à l’esprit pendant le mois triste, épuisant et en colère qui a suivi l’explosion, d’autant plus que j’ai traversé les zones les plus touchées face au port avec des milliers d’autres qui sont venus aider aux efforts de secours et de nettoyage dans le ville où Adnan est né.
Le livre comprend deux lettres qu’elle a écrites de Beyrouth, l’une d’août 1991 et l’autre à peu près à la même époque l’année suivante. Les deux ont été écrits peu de temps après la brutale guerre civile libanaise qui a duré de 1975 à 1990; dans sa prose typiquement astucieuse, ils détaillent l’état d’être d’Adnan dans le contexte de ses sorties, rencontres et observations des conditions dans la capitale. Les guerres et les déplacements occupent une place importante alors que l’auteur met à nu chaque histoire tragique et chaque récit d’exil. Dans sa critique pour le Nation en 1994, le poète et critique américain Ammiel Alcalay a fait remarquer qu’en Des villes et des femmes, «Adnan incarne le rôle à la fois de visionnaire et de chroniqueur, voyant ce qui est à venir en dévoilant des façons acceptées de recevoir et d’enregistrer le passé.»
Je suis retourné à ce livre pour voir si mes propres souvenirs vifs et impressionnistes des habitants et des paysages de la ville trouvaient des échos dans les descriptions d’Adnan d’il y a près de 30 ans. Plus je lisais, plus je voyais Beyrouth d’aujourd’hui dans ses écrits.

Photo: Hussein Malla / AP Photo
Dans sa lettre de 1992, Adnan a pleuré la perte de son amie proche et galeriste Janine Rubeiz, décédée des suites d’une maladie. Dans un passage, Adnan note que «ce qui vous sauve du désespoir à Beyrouth, c’est la difficulté même d’y vivre. Il fait si chaud que vous avez l’impression de stocker de l’eau pour transpirer, lorsque vous buvez. Votre esprit cesse de fonctionner. Cela prend de longs repos. Vos pensées prennent congé. Evoquant les 15 années de conflit qui n’avaient cessé que récemment, elle poursuit: «La guerre est finie mais ce n’est pas le cas. Cela a changé de forme et de tactique. Il y a tellement d’incertitude et la seule vérité à laquelle vous pouvez vous accrocher est pitoyable; le fait que ce pays soit ingérable. Ensuite, la mer derrière mes fenêtres n’est plus une alliée. Elle ressemble trop au soleil et me brûle les yeux. Elle est devenue aussi terrifiante que les chefs de la milice.
Ce sont les descriptions d’Adnan de Beyrouth – en particulier la façon dont sa lumière porte «un sentiment de mort» – qui me ramena à ses lettres. Et en effet, ses propos sont si douloureusement prémonitoires, si précis, c’est comme si elle les avait écrits en 2020, dans les jours qui ont suivi l’explosion qui a fait sauter une ville déjà secouée par les crises financières et sanitaires successives dont elle continue de souffrir.
La dévastation causée par 250 tonnes d’ammonium qui a explosé dans le port a tué près de 200 personnes, blessé des milliers de personnes et laissé des quartiers entiers en ruine, alors que plus de 300 000 personnes sont devenues sans abri. Six mois après l’explosion, les habitants de Beyrouth n’ont toujours pas reçu d’excuses de la classe dirigeante. Plusieurs fonctionnaires, ministres et même le président de la république lui-même étaient au courant de la présence du produit chimique mortel, qui avait été stocké au port pendant six longues années. Mais encore, pas une seule personne n’a été tenue pour responsable et les enquêtes restent – sans surprise – peu concluantes.
Sans attendre la réponse de l’État, les efforts de secours et les appels aux dons qui ont surgi immédiatement après la tragédie se sont poursuivis dans les mois qui ont suivi. Les quartiers les plus proches du site de l’explosion – qui abritent de nombreux musées, galeries, studios de design et organisations artistiques de Beyrouth – avaient été décimés. Le musée historique Sursock a subi des dommages importants. La Fondation Arab Image, qui abrite des centaines de milliers de photographies de la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord), a été ouverte. Les murs de la Sfeir-Semler Gallery et du Beirut Art Center se sont effondrés. Et toutes les petites et moyennes galeries et espaces d’art établis dans les quartiers de Gemmayzeh et Mar Mikhaël au cours de la dernière décennie – ainsi que les maisons et les studios de nombreux artistes qui vivaient autour du port – étaient une épave complète.

Photo: Hussein Malla / AP Photo
Cela avait déjà été une année très difficile pour les espaces artistiques. Le pays a sombré dans une crise financière catastrophique à l’automne 2019, alors que les soulèvements du 17 octobre faisaient rage dans les rues. Les espaces artistiques se sont fermés en solidarité avec les soulèvements, alors que les artistes et les travailleurs culturels se sont joints aux manifestations. La situation financière a continué de se détériorer et les banques locales ont rendu de plus en plus difficile de travailler sous les contrôles de capitaux stricts qu’elles imposaient. Les économies des gens avaient disparu lorsque la pandémie est arrivée, ne faisant qu’empirer les conditions de vie et le pouvoir d’achat d’une population déjà précaire et appauvrie. Lorsque le Liban est entré dans son premier verrouillage en mars, les espaces artistiques s’étaient prudemment préparés à reprendre leurs activités à l’automne.
Dans l’instant qui a suivi l’explosion et les mois qui ont suivi, il semblait que rien ne pouvait nous empêcher de sombrer davantage dans le désespoir. La pandémie nous ayant accablé d’une incertitude angoissante sur l’avenir, l’explosion désastreuse a détruit toute lueur d’espoir. Pourtant, après que la vague initiale des secours et des efforts humanitaires se soit calmée, plusieurs événements ont fourni des moments de réflexion. Quelques jours avant l’annonce d’un deuxième lock-out en novembre, j’ai assisté à une série de concerts organisés par Irtijal, un festival international de musique expérimentale au Liban (dont le nom arabe signifie «improvisation») au studio Zoukak, un autre espace dynamique de Beyrouth qui a été endommagé dans l’explosion mais est resté suffisamment opérationnel pour accueillir l’événement. Irtijal devait célébrer son 20e anniversaire au printemps dernier, mais a été annulé en raison de la pandémie. Les organisateurs ont décidé de passer par une édition compacte du festival début novembre, avec une programmation composée exclusivement de musiciens basés à Beyrouth, et un sens de la collectivité qui a été une bonne surprise car il a réuni des amis et des personnes que j’avais pour la dernière fois. vu couvert de poussière, avec des pelles à la main. Si la plupart de la musique était rauque et brute, elle invoquait une immobilité rassurante que nous n’avions pas ressentie depuis un moment – et la preuve que l’explosion n’avait pas tout éradiqué après tout, qu’il était possible de continuer à faire de l’art et, surtout, de prenez à nouveau plaisir à découvrir ce que l’art a à offrir.
Dans les espaces qui ont pu s’ouvrir après l’explosion et avant d’entrer dans un deuxième verrouillage, d’autres activités étaient prévues. Ashkal Alwan, une organisation qui promeut et expose l’art contemporain, a ouvert ses studios aux artistes qui avaient perdu leurs espaces dans l’explosion, et a annoncé la résurrection de son programme Home Work Space, avec des bourses pour les artistes «pour explorer libre, transdisciplinaire, modèles critiques d’éducation artistique au Liban et dans la région arabe. »

Avec l’aimable autorisation de l’artiste
Partout dans le monde en octobre, un programme de résidence a été rapidement mis en place dans le village côtier de Boiçucanga au Brésil par Temporary Art Platform, une organisation créée par la commissaire Amanda Abi Khalil pour accueillir sept artistes libanais et leur offrir du temps et du dépaysement. recharger. Lorsque j’ai discuté de Zoom avec Lara Tabet, une photographe qui était l’une des participantes au programme, elle a exprimé sa réticence initiale à quitter Beyrouth. «C’était aussi stressant pour moi de partir que de rester», a-t-elle dit, citant l’intense anxiété au sujet du futur proche au Liban et le fait que tout pouvait mal tourner à tout moment. «Je suis triste de dire que c’était [a relief] être absent », a-t-elle poursuivi,« bien que ce sentiment d’errance ou de vie dans une réalité alternative puisse également être pénible. » Malgré cela, Tabet a parlé de l’importance de la parenté offerte par le programme et du fait qu’elle a pu connaître beaucoup mieux d’autres artistes, qu’elle comptait auparavant comme des connaissances.
Le 13 novembre, la veille du début du deuxième lockdown, je suis allé au Beirut Art Center pour voir une exposition de nouvelles vidéos et installations du cinéaste et artiste de Beyrouth Mohamed Berro; y figuraient également des travaux d’une série de «Micro-Commissions» en trois parties qui invitaient des artistes et illustrateurs locaux à répondre à différentes invites autour de questions de surveillance parrainée par l’État, de stratégies de soins et de réflexions sur les réalités du Liban au-delà des limites de la représentation . Alors que la mise en page du spectacle était clairsemée, les œuvres exposées reflétaient des interventions réfléchies sur les conditions politiques, sociales et émotionnelles d’une année totalement implacable.

Avec l’aimable autorisation de l’artiste
Plus tard dans la soirée, je me suis rendu au Sunflower Theatre pour regarder une production conçue et écrite par un jeune groupe d’acteurs palestiniens et libanais dirigé et dirigé par Lama el Amine et Victoria Lupton de Seenaryo, une organisation artistique et éducative au Liban et en Jordanie. qui fonctionne avec les jeunes réfugiés. La performance a pris son titre du poème de l’écrivain palestinien Mahmoud Darwish «I See My Ghost Coming From Afar», dans lequel l’auteur – tel que décrit par Sarah Irving dans un essai dans L’Intifada électronique à partir de 2015 – «signale une sorte d’omniscience, revendiquant une connaissance de son propre passé qui défie l’appropriation et la distorsion.» Les jeunes acteurs ont joué le rôle de fantômes qui étaient invisibles au monde qui les entourait mais qui tiraient le meilleur parti de leur temps en tant que revenants. Un peu de texte dans la brochure du programme de l’émission disait: «Il y a des rêves de mer et une mer de rêves. Nous tentons une révolution contre les morts, les vivants et nous-mêmes.
Depuis des mois maintenant, certains d’entre nous à Beyrouth se sont appelés les morts-vivants – ayant survécu sans être entièrement vivants. Mais ces jeunes esprits étaient un témoignage de la vie qui traverse l’endroit que nous appelons chez nous. Leur performance était un exemple de ce qui peut découler du dévouement et du soin les uns des autres, articulé par une admirable obstination créatrice envers les conditions auxquelles ils continuent de faire face en tant que jeunes dans une société qui les diffuse et les rejette souvent.
La partie du texte sur «les rêves de la mer et une mer de rêves» m’a ramené à l’évocation par Adnan de la mer au-delà de ses fenêtres et de son double potentiel à trahir les rêves qu’elle peut inspirer. «La mer derrière mes fenêtres n’est plus une alliée», écrit-elle. Mais si tout reste incertain et sombre, ce qui reste vrai, c’est le courage des artistes, des musiciens, des écrivains et de tous les praticiens culturels de Beyrouth qui persistent dans les temps les plus effrayants et les plus éprouvants. Si, comme Adnan le suggère, la mer n’est parfois «d’aucune aide», elle recèle encore du potentiel pour ceux d’entre nous qui se sentent invisibles mais très vivants.