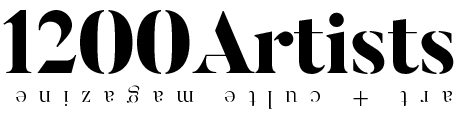Le peintre Paul Cadmus a un jour fait remarquer que, dans les années 1930, les homosexuels à New York étaient simplement appelés artistes. Comment queerness est devenu synonyme d’art est vraiment une histoire de modernisme
elle-même, pleine de codes privés et de mécénat intime. Pensez à la coterie avant-gardiste de Gertrude Stein à Paris, ou au salon contemporain de Natalie Barney sur la rive gauche, ou au propre cercle de Cadmus à
New York. Depuis au moins Oscar Wilde, queerness et esthétisme sont liés dans l’imaginaire public.
« Les premiers homosexuels : représentations mondiales d’une nouvelle identité, 1869-1930 », une exposition à Wrightwood 659 à Chicago, cherche à souligner ce fait à grande échelle. L’émission était destinée à être une seule enquête à succès jusqu’à ce que la pandémie oblige les conservateurs – une équipe de 23 universitaires dirigée par Jonathan D. Katz et Johnny Willis – à la scinder en deux parties. La première moitié rassemble une centaine d’œuvres dans divers médias de plusieurs pays (principalement occidentaux); le deuxième volet, plus important, qui ajoutera plus d’artistes du Moyen-Orient, d’Amérique latine et d’Asie, ouvrira à Wrightwood en 2025.
Comme son titre l’indique, l’exposition commence par le mot gênant lui-même. Le journaliste hongrois Karl Maria Kertbeny est crédité d’avoir inventé le terme homosexuel en 1869 pour désigner un groupe distinct de personnes plutôt qu’un comportement. Le mot avait des implications juridiques et médicales qui étaient plus utiles aux bureaucrates qu’au grand public. Mais à la fin du XIXe siècle, lorsque le médecin britannique Havelock Ellis et l’écrivain John Addington Symonds ont écrit Inversion sexuelle, leur étude historique sur l’homosexualité, le terme était en vogue. Conceptuellement, « Les premiers homosexuels » vise à examiner comment le mot naissant et son identité qui l’accompagne ont filtré et influencé l’art visuel au cours des décennies suivantes. Un tel travail inspirait-il ou envisageait-il une conscience de soi que le langage écrit ne pouvait pas ?
Les réponses proposées ici sont mitigées. À certains égards, l’incomplétude de l’exposition nuit à son impact. Les six décennies cartographiées offrent une contrainte temporelle sans cohésion narrative, une lacune à laquelle même le texte mural ouvertement éditorialisant ne peut remédier. Au lieu de faciliter un jeu esthétique et un dialogue organique entre les œuvres sélectionnées, les commissaires optent pour une approche curieusement anthropologique. Cela se reflète dans la conception de l’exposition : chaque petite pièce, peinte d’une couleur distincte et reliée aux autres par des arcades qui évoquent les salons bohèmes de Stein ou Barney, présente l’une des neuf catégories thématiques : « Avant l’homosexualité », « Archétypes », « Désir », « Passé et futur », « Public et privé », « Colonisation », « Entre les sexes », « Pose » et « Couples ». Le travail est suspendu de manière non chronologique, il n’y a donc aucun sens de continuité ou de progression, juste un éclectisme diligent.
Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de joyaux à voir. du peintre britannique Duncan Grant Baigneuses au bord de l’étang (1920-1921), une scène de baigneurs masculins langoureux rendus à la peinture pointillée et aux tons terreux, inspire la rêverie. du peintre américain Charles Demuth Huit heures (tôt le matin), 1917, est une aquarelle tendre dans laquelle deux hommes – l’un assis en pyjama abattu, l’autre debout implorant en sous-vêtements – partagent un moment de domesticité ambiguë tandis qu’un autre homme (nu) se lave le visage à un lavabo en arrière-plan. Étude de la maison de bain (sans date), un dessin à la pierre noire de l’artiste suédois Eugène Jansson (1862-1915), dépeint une configuration presque géométrique d’hommes nus, chacun suspendu dans sa propre accalmie érotique – un tableau qui ne serait pas déplacé dans le les œuvres de la fin du XXe siècle des Américains Patrick Angus ou John Burton Harter.
D’autres œuvres ici font allusion à des courants culturels plus profonds. Un mur de photos d’archives documente l’Elisarion, un temple néo-religieux que le poète et artiste Elisàr von Kupffer a construit en Suisse avec son partenaire, le philosophe Eduard von Mayer. Ces images, dont certaines montrent des hommes portant des couronnes et des sarongs de fortune prenant des poses dans la nature, évoquent l’esprit utopique qui a insufflé la vie queer transatlantique au XIXe et au début du XXe siècle, incarné, par exemple, par le poète américain Walt Whitman et son homologue britannique. , Edouard Charpentier. Force croissante (1904), une imposante peinture à l’huile de l’artiste allemand Sascha Schneider, dépeint un bodybuilder chevronné évaluant les biceps d’un jeune acolyte – un précurseur des magazines de physique et du «culte du corps» qui ont défini la vie gay au milieu du siècle et au-delà.

Avec l’aimable autorisation d’Alphawood Exhibitions LLC, Chicago
A son crédit, l’émission va aussi au-delà d’une conception strictement masculine ou anglophone de l’homosexualité. Les photographies de la carte de visite du couple norvégien Marie Høeg et Bolette Berg montrent les femmes habillées en hommes, ou dans des tenues plus androgynes. De même, les photos d’Alice Austen, l’une des premières femmes américaines à prendre des photos en dehors du studio, capturent des moments ludiques, bien que cachés, de la socialité lesbienne. Peintures et parchemins d’artistes japonais et chinois, dont plusieurs sont inconnus, offrent les intermèdes les plus explicitement érotiques du spectacle, comme dans une estampe illustrant une sinueuse orgie mixte. Ailleurs, un photographe inconnu dépeint deux acteurs noirs, dont un en drag, dansant le cakewalk à Paris au tournant du siècle. Extrait du film muet de Louis Lumière Le Cake-Walk au Nouveau Cirque (1903), le plus ancien enregistrement connu d’une performance de drag, joue sur un moniteur à proximité. Encore plus d’un siècle plus tard, les images d’artistes mettant en scène une danse issue d’esclaves dégagent une jubilation obsédante à la fois insouciante et entachée par les sectarismes de son époque.

Avec l’aimable autorisation d’Alphawood Exhibitions LLC, Chicago
Une poignée de pièces se sentent à la dérive. Le portrait de 1912 du peintre américain Romaine Brooks du poète nationaliste italien Gabriele D’Annunzio, une ressemblance sobre dans la palette grise caractéristique de Brooks, est un choix déroutant. (D’Annunzio, un infâme coureur de jupons, n’était pas homosexuel, et il plane avec une hauteur sans joie sur la pièce.) Un autoportrait de Brooks – ou l’un de ses nombreux portraits de femmes contemporaines – aurait été un choix plus fort. Avec trois peintures exposées, l’artiste canadienne Florence Carlyle se voit attribuer plus d’espace mural que ne le méritent ses portraits de femmes élégants mais autrement ennuyeux. Et la section « Colonisation » de l’émission, qui tente d’explorer comment les attitudes occidentales envers l’homosexualité ont divergé de celles des populations autochtones et orientales, est insuffisamment cuite. Wilhelm von Gloeden, le photographe allemand qui a décampé en Italie pour mettre en scène des fantasmes pastoraux avec des garçons siciliens nus, est inclus ici, bien que son rôle de colonisateur soit discutable.
Au final, l’exposition a le ton d’un manuel de sociologie : sérieux, pédant, souvent plus majestueux qu’enivrant. La prémisse même semble erronée. Ce n’est pas comme si 1869 était un moment eureka qui lançait massivement les artistes queer dans des carrières d’autoreprésentation. La laïcité croissante, l’urbanisation et les médias de masse ont fait plus pour définir l’identité homosexuelle que l’invention du mot lui-même, mais ces réalités restent ici soit inexplorées, soit obliques. Au lieu de retracer l’histoire du modernisme en arrière-plan, les conservateurs livrent une histoire confuse Wunderkammer. Pour un spectacle qui prend soin de cadrer l’homosexualité comme fluide, la disposition thématique se révèle rigide et délimitante. En espérant que le deuxième versement se détende.